

Le choc des cultures
De la DGA à Google, on change radicalement d’univers, et en particulier d’environnement de travail. Quelles leçons en tirer en matière d’autonomie, de confort, de contrôle et finalement de productivité dans une entreprise de 100 000 personnes clairement dans l’âge adulte. Une invitation à reconsidérer les méthodes de travail et d’organisation ?
La DGA possède de nombreux arguments pour attirer des talents : des sujets hors du commun hautement technologiques, des moyens conséquents (>10Mds€), une grande responsabilisation des ingénieurs, même juniors, qui se retrouvent acteurs principaux de la conception et du développement des systèmes dont ils ont la charge, et une histoire plus que respectable. Cela permet de dépasser des inconvénients, dont ceux d’une politique salariale moins avantageuse que celle du privé. Cependant, d’autres inconvénients la font parfois qualifier de « grand-mère » et mériteraient de s’inspirer des entreprises du numérique, qui possèdent elles aussi une spécificité de leurs missions, une grande complexité des projets, un temps long et des contraintes administratives.
Ainsi Google est une entreprise de plus de 100 000 salariés, présente dans la majorité des pays du monde opérant dans autant de langues, de juridictions, de contexte sociaux et économiques. Le moteur de recherche existe depuis 1998 et lorsque l’on observe aujourd’hui l’ensemble des systèmes matériels et logiciels que Google met en œuvre dans tous les domaines (cloud, datacenters, IA par exemple), il me semble que la complexité, si elle ce n’est supérieure, n’est en tout cas pas inférieure. Dans ce que j’ai pu observer depuis que j’y suis, cette impression d’agilité, d’efficience et d’innovation s’appuie sur une culture que l’organisation a su cultiver et perpétuer au fil des ans, évoluant avec la taille et la complexité de l’entreprise, additionnée à un certain nombre de capacités qui font souvent défaut à l’administration française.
La culture du choix
Les volumes de travail excèdent très largement les ressources humaines disponibles : il y a trop à faire et trop peu de gens pour le faire. Deux attitudes possibles : ne renoncer à rien et essayer de couvrir le maximum de projets sans jamais exceller, ou au contraire prioriser et dédier l’ensemble des ressources disponibles aux objectifs prioritaires. Cette dernière option se heurte à la crainte de l’erreur, de l’opportunité manquée. C’est pourtant un exercice sain et nécessaire, qui demande beaucoup d’investissement, de communication, et aussi de courage de la part de la hiérarchie et du plus haut niveau du management. Dans la tech, il s’agit d’un exercice trimestriel (au plus) qui implique tous les niveaux du management : depuis le haut, chaque échelon définit ses objectifs en déclinant à son niveau ceux de l’échelon supérieur et cela jusqu’au niveau des individus (ce sont donc bien eux qui sont à l’initiative). Le résultat de cet exercice est public et permet à chacun de consulter les objectifs de leurs pairs ou du management, facilitant ainsi coopérations et décisions en affichant clairement les priorités de chacun pour faire des choix : on analyse les ressources disponibles, on priorise, on renonce et on réoriente.
La culture de la compétence
Le mécanisme de fixation des objectifs décrit part d’une hypothèse forte : les individus sont capables de fixer leurs objectifs en toute autonomie de façon pertinente pour l’organisation. Les managers ont alors un rôle de conseillers et non de donneurs d’ordres, car souvent plus expérimentés et plus à même de questionner la priorisation, le volume de travail et la complexité des objectifs proposés. La raison pour fonctionner ainsi: “nous recrutons des talents non pas pour leur dire quoi faire, mais au contraire pour que ce soit eux qui nous disent quoi faire”. Sinon, on se retrouve dans une situation où l’on emploie des gens trop compétents dans des postes dans lesquels ils n’ont qu’un rôle d’exécution pour lequel ils sont surqualifiés. La compétence et son évaluation est absolument centrale dans un tel dispositif : il n’y a pas de management à proprement parler, seulement des personnes plus expérimentées qui ont un rôle transverse de manager en plus de leurs fonctions. Ainsi, tous les échelons de l’organisation sont acteurs et actifs, et les niveaux (mesure quantitative de la compétence en interne) définissent simplement l’impact qu’une personne doit avoir, et bien entendu, plus le niveau est élevé, plus l’impact attendu est important. C’est d’ailleurs ce dernier qui est évalué de façon biannuelle, sans lien avec l’atteinte ou non des objectifs, devant simplement répondre à la question “quel a été mon impact sur l’organisation dans son ensemble au cours des 6 derniers mois ?”.
Le principe de subsidiarité
La question suivant naturellement est relative à l’atteinte des objectifs : si je définis moi-même mes objectifs sans une hiérarchie qui les valide et ainsi les appuie, comment faire avancer mes projets ? La réponse se trouve dans la structure. Alors que certains parlent d’organisation “plate” ou même de non-organisation complète, la clé se trouve dans une structure matricielle classique, mais dans laquelle on responsabilise fortement les individus. Euxseuls sont maîtres de leurs projets, et n’ont des comptes à rendre qu’a posteriori et non pas a priori ce qui simplifie grandement les processus et accélère la vitesse d’exécution. Les prises de risques et les initiatives sont nécessaires, valorisées et récompensées pour atteindre des objectifs ambitieux.
L’autonomie des individus suppose également un choix fort et assumé de mettre l’ensemble des moyens nécessaire à disposition pour qu’ils puissent accomplir leurs objectifs. A titre d’exemple, le télétravail est supporté par un des outils qui permettent de travailler comme au bureau dès lors que l’on dispose d’une connexion à internet. Les équipes sont distribuées dans le monde entier, ce qui rend un outillage efficace en matière de travail collaboratif et de visioconférence absolument indispensable.
Une cantine sans caisse !
Les conditions de travail sont également point d’attention important. A titre d’exemple, boissons, nourritures sont gratuitement disponibles près des espaces de travail. Comble: les cantines n’ont même pas de caisses !
La confiance
C’est une condition nécessaire à la mise en œuvre de la responsabilisation et à l’autonomie des individus qui irrigue également l’ensemble des processus de l’entreprise. Prenons l’exemple des missions et des dépenses: celles-ci sont gérées par l’intermédiaire d’une carte bleue de l’entreprise dont dispose chaque employé (et qui ne débite jamais les comptes personnels). Le traitement des notes de frais est ainsi entièrement numérique et automatisé et soumis seulement à l’approbation du manager. Ces notes incluent des dépenses de type fournitures ou services peu onéreux (par exemple des travaux d’impression pour un événement se comptant en milliers d’euros), qui ne nécessite donc aucune autorisation préalable mais est soumise en jugement de l’individu (et de son manager) : “est-ce que cette dépense est nécessaire ? Légitime ? Utile ?”. Quand on y réfléchit, les gains financiers d’efficacité, d’énergie, de temps pour les individus ainsi que l’économie de personnels dans des services chargés de la vérification rendent la souplesse directement rentable. Et en cas d’abus (rares), la personne en subirait les conséquences et l’entreprise ne perdrait finalement que très peu en comparaison des économies réalisées.
Le refus de l’inertie et de l’inefficience
C’est probablement la caractéristique qui m’interpelle le plus pour une organisation dont le fonctionnement interne est sans nul doute beaucoup plus complexe qu’une administration telle que la DGA. En effet, il est communément accepté qu’un processus inefficient doit être changé, et n’importe quel individu qui le souhaite peut prendre à sa charge de l’améliorer et de le transformer pour peu que le constat soit partagé. Ceci s’inscrit dans la perspective de la responsabilisation et l’autonomie des individus. Ainsi rien n’est gravé dans le marbre, aucun processus, aucune méthode n’est fixée, et est amenée à évoluer de multiples fois au cours de son existence au gré des changements de contextes et des appréciations de ceux qui les mettent en œuvre. Selon un dicton interne : la seule constante, c’est le changement.
Aucune de ces caractéristiques n’est le fruit d’un différenciateur fondamental entre une organisation comme la DGA et un géant de la tech tel que Google. C’est le résultat d’une culture et d’un mode de pensée qui, même s’il est difficile à exporter, mérite au moins que l’on s’en inspire pour améliorer nos propres structures. C’est une nécessité car ces environnements sont en train de définir les standards de demain, et si aujourd’hui les organisations classiques sont la majorité, ce ne sera peut-être plus le cas demain, alors qu’il sera déjà trop tard pour se transformer.
 |
Bertrand Rondepierre, IA, responsable du centre de recherche de Paris de Google
X2010, Telecom et Master MVA à l’ENS, Bertrand débute à la DGA dans le domaine de l’IA et du « big data ». Il est également architecte du projet ARTEMIS. En 2017, il fait partie de l’équipe de Cédric Villani dans le cadre la mission intelligence artificielle et rejoint Google en 2018.
|



















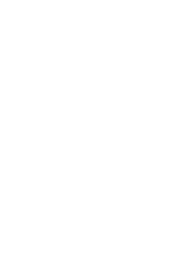
Aucun commentaire
Vous devez être connecté pour laisser un commentaire. Connectez-vous.