

L’INDUSTRIE, UNE QUESTION DE SOUVERAINETÉ ?
La France a depuis longtemps fait le choix de la souveraineté en matière de défense, ce qui implique souveraineté en matière d’industrie de défense. C’est une donnée historique et un héritage que les présidents, depuis le Général de Gaulle, ont régulièrement rappelé et pris à leur compte, la dernière fois à l’occasion de la publication du livre blanc 2013.
Mais qu’appelle-t-on la souveraineté et la recherche de l’autonomie stratégique qui en découle ? Sur un plan général, il faut revenir vers le Livre Blanc de la Défense et la Sécurité Nationale. Sur le plan industriel et plus précisément dans le domaine de l’armement, c’est la capacité à faire, à produire, à vendre et à utiliser les équipements sans autres contraintes que celles que la France se donne, au titre de sa réglementation et des traités qu’elle signe, qui détermine cette autonomie.
A titre personnel, j’aime rappeler le fait que la petite histoire rapporte que ce qui a finalement motivé la décision de lancement du programme Ariane, ce sont les conditions que les américains, seuls détenteurs d’une capacité spatiale commerciale à l’époque, voulaient imposer aux programmes européens de satellites de télécommunications lancés par eux, conditions qu’on pourrait résumer par « OK pour vous lancer, mais à condition que vos produits ne fassent pas concurrence aux nôtres ».
L’autonomie industrielle, ce sont au premier chef des compétences. Disposer des compétences, notamment pour l’ingénierie, au meilleur niveau mondial est une condition évidemment nécessaire pour pouvoir développer les systèmes attendus par les forces ou les clients export (dans certains cas, c’est également une condition nécessaire pour négocier d’égal à égal avec nos alliés dans un rapport de force bien maitrisé). Mais cela est rarement suffisant : l’outil et les savoirs faire de production sont aussi essentiels que les compétences d’ingénierie et on a trop souvent tendance à l’oublier. On a aussi trop souvent tendance à croire qu’il suffit de déverser des études dans l’industrie pour que les compétences soient maintenues, c’est une erreur : allez motiver un ingénieur sans lui donner une perspective de « bon gros programme » ! Et savoir terminer un programme est aussi une vraie compétence… Enfin, rien ne sert d’avoir des compétences si l’industriel, faute de commandes export ou de relais de croissance, est obligé de mettre la clef sous la porte !
L’exercice est toujours complexe, peut être de plus en plus à mesure que les contraintes se resserrent, comme les budgets : écart temporel entre les programmes de plus en plus important, complexité de plus en plus prégnante, nombre de technologies en accroissement fort, avec un changement de paradigme industriel évident : les entreprises doivent être dans le bain de la mondialisation, elles doivent être rentables et l’activité défense devient trop souvent de plus en plus marginale.
Décider dans ces conditions d’être souverain et mettre en place cette autonomie industrielle, cela suppose se donner une ligne de comportement qui passe notamment par ce qu’on pourrait appeler une politique industrielle. Peut-être plus au sens où l’entendaient les hommes politiques des années 60/70, voire 80 (on repensera au « plan calcul », au « plan téléphone » qui représentaient eux aussi des investissements considérables et ont été, partiellement, des échecs) mais une politique dans le sens d’une logique d’action long terme, qui s’appuie sur l’ensemble des rôles que l’Etat est amené à jouer vis-à-vis de l’industrie. Dans un marché qui reste, fondamentalement un monopsone (un seul client national, très peu de fournisseurs) mais aussi un marché très régulé et peu liquide, l’Etat peut se placer dans quatre postures : état actionnaire, Etat client, Etat stratège et Etat régulateur pour appréhender toute sa relation avec l’industrie et construire son indépendance :
- État client, au premier chef : c’est par une politique d’achat claire, lisible et stable qu’on assure la défense de l’industrie de défense et son acceptabilité pour les actionnaires ; une politique qui fait la part des choses entre ce qui est accessible sans contraintes sur le marché international et ce qui est essentiel dans nos programmes, soit parce que trop dépendant d’un éventuel fournisseur étranger (et des règles d’exportation qui s’imposent à lui), soit parce que trop sensible pour la performance d’un système.
- État « stratège » : dans une industrie ou la fonction marketing est quasi inexistante parce que le marché est (pour le moment encore) plus guidé par la demande que par l’offre, garantir la pertinence des orientations pour la préparation du futur est une obligation ardente pour assurer la performance des produits pour nos forces et pour l’export; le développement des ASF dans les années 1990, le passage à la MASD maintenant sont des leviers essentiels de défense de notre industrie et de préparation de sa capacité à rester « world class » ;
- État actionnaire : longtemps, le principe de l’Etat actionnaire a été le principe cardinal de la souveraineté nationale et de l’autonomie industrielle ; si le dogme de la détention majoritaire n’est plus que marginal dans un certain nombre d’entreprises, l’expérience montre qu’avoir un siège au conseil d’administration et surtout des droits au titre d’un pacte d’actionnaires (sans peut être aller jusqu’à la généralisation des actions spécifiques) reste un élément fondamental de connaissance des orientations des entreprises et permet de peser sur leur stratégie ; rien ne dit d’ailleurs qu’on n’assistera pas à une résurgence du principe de l’état actionnaire sous des formes peut être un peu différentes à court terme.
- État « régulateur » : le marché de la défense est par construction un de ceux qui présentent le plus de contraintes, à la fois dans l’établissement des entreprises (délivrances d’autorisations), dans le commerce (un seul client national in fine, la nécessité de passer par la CIEEMG pour les autres) mais aussi dans la transmission des entreprises (voir infra).
L’autonomie industrielle, c’est en second lieu la « non dépendance » vis-à-vis d’acteurs étrangers dont les motivations seront parfois difficiles à gérer : volonté de rationalisation industrielle, pillage technologique, intérêts stratégiques ou économiques divergents, suppression de la concurrence… La liste est longue des maux généralement associés avec le spectre d’une entrée d’investisseurs étrangers, avec un degré de fantasme souvent important mais des risques réels et parfois avérés.
« …il vaut mieux prévenir que guérir. »
Bien entendu, l’internationalisation croissante des entreprises et avec comme corollaire l’accroissement des investissements étrangers en France renforce la question traditionnelle de la protection des industries stratégiques face à ce que certains voient comme un prédation de l’excellence des compétences et capacités technologiques et techniques nationales. Il y en a mais pas que et l’essentiel des investissements ont une vraie vocation industrielle, largement appelée par le gouvernement. Pour accompagner ces mouvements, le décret IEF (voir encadré, largement remis au gout du jour par le ministre Montebourg), soumet à l’autorisation du gouvernement tout évolution significative de l’actionnariat d’une entreprise ou d’une branche d’une entreprise, au bénéfice d’un ayant droit étranger ; cette autorisation, délivrée par le ministère de l’économie (la Direction Générale du Trésor), s’élabore avec la DGA dès lors que des questions de défense sont traitées par l’entreprise cible, et s’avère in fine possiblement très contraignante ; les sanctions en cas de non-respect des engagements qui sont pris par l’investisseur (ou en cas de non soumission de l’investissement) sont pour le coup réellement dissuasives ;
Tout bon médecin vous dira qu’il vaut mieux prévenir que guérir. C’est la raison pour laquelle, dans le cas d’entreprises « systémiques » avec lesquelles l’Etat à une relation historique, existent des conventions de protection de ses intérêts. Ces conventions précisent pour la plupart les principes d’information mais aussi les règles de reprise éventuelle de capital, d’actifs, et de droits de préemption (mécanismes de PUT, de CALL), de première offre, de premier refus, des contraintes de gouvernance (participation ou non au conseil d’administration), des obligations d’immunité (vis-à-vis de réglementations étrangères par exemple), dans une « jurisprudence » en constante évolution. La préparation et la négociation de ce type d’engagement, avec le volet essentiel de leur évaluation au fil du temps, sont un challenge pour les ingénieurs de l’armement qui découvrent souvent à cette occasion les grands principes de la gouvernance d’entreprise.
Ce dispositif national n’a pas à rougir d’une comparaison avec ceux de nos partenaires, ni même avec le fameux CFIUS[1] américain tant redouté. La pratique de notre IEF, surtout dans ses évolutions récentes, montre qu’on peut en tirer des mécanismes très performants. Par contre, et contrairement probablement à l’exemple américain, force est de constater que ce qui fait défaut en France, c’est plus la profondeur du capital accessible que le dispositif permettant d’encadrer ces prises d’investissement étranger : il est toujours difficile de négocier quand un seul repreneur existe pour une entreprise en difficulté…
Peut-on, à ce stade de l’article, faire l’impasse sur la question européenne ? Théoriquement non, parce que la question de la défense européenne, qui est dans toutes les conclusions des sommets européens, appelle nécessairement une analyse sous l’angle industriel. Pratiquement, oui : parce que la défense ne rentre pas (pour le moment) dans le champ des traités européens, parce que définir une notion d’industrie européenne s’avère encore plus délicat que définir une notion d’entreprise française (le lecteur aura remarqué que je ne m’y suis pas risqué), parce que la question de la souveraineté et de l’indépendance stratégique sont un tabou pour certains partenaires, parce que la notion de « préférence européenne » est parfois un gros mot etc. Il n’y a pas d’industrie de défense européenne et la route est encore longue avant qu’on ne vive une réelle politique industrielle de défense au niveau européen, même si les frémissements sont là, avec cependant des incertitudes majeures (conséquences du Brexit, place de la dissuasion…). Ce qui justifie avec sans doute encore plus de force le maintien de la posture française.
Doit-on se contenter de ces outils, de cette constance, de cette vision industrielle et de cette cohérence de comportement entre toutes les composantes du ministère et surtout de la DGA pour considérer que la question de la souveraineté de la France en matière industrielle est assurée ? Certainement pas dès lors que l’environnement continue de changer : l’accélération de l’histoire des technologies, le raccourcissement des cycles qui bénéficient à nos concurrents (ou adversaires), les montants gigantesques de financement disponibles dans certains pays pour l’innovation, la marginalisation d’une activité défense qui peine à maintenir les volumes de production, la mondialisation sont autant de paramètres qu’il faut prendre en compte. En attendant la concrétisation d’une dimension européenne de l’industrie, il faudra que la DGA innove dans ses relations et développe d’autres formes de liens avec l’industrie pour la protéger, parfois à l’insu de son plein gré. C’est à l’étude.
[1] Comittee for Foreign Investments in the US
 |
Bertrand Le Meur, IGA
Bertrand Le Meur (X85) a commencé sa carrière au STEI en 1990 ou il s’est essentiellement occupé de télécommunications par satellites jusqu’en 1997. Après un passage de deux ans à la DPM, comme chef de bureau, il a occupé diverses fonctions de direction chez SFR entre 1999 et 2009. Il est depuis février 2014 chef du S2IE.
|











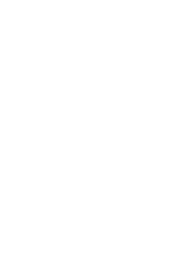
Aucun commentaire
Vous devez être connecté pour laisser un commentaire. Connectez-vous.